
Face aux enjeux environnementaux grandissants et aux tensions sur le secteur automobile, la fiscalité liée aux véhicules à faibles émissions s’impose comme un levier essentiel pour orienter la transition vers une mobilité plus propre. Depuis l’entrée en vigueur progressive des nouvelles règles en 2025, les entreprises et professionnels doivent repenser la gestion de leur flotte avec soin. Cette réforme intègre l’évolution des taxes sur les émissions de carbone, la fin des exonérations pour certains hybrides et l’instauration d’une taxe incitative sur les flottes de plus de 100 véhicules. Elle reflète une volonté forte du Ministère de la Transition écologique et des politiques publiques relayées sur sites comme Gouvernement.fr, Impots.gouv.fr ou Service-Public.fr, visant à remodeler en profondeur la fiscalité automobile. Ce cadre nouveau, complexe mais stratégique, impacte directement les grandes marques telles que Renault, Peugeot, Citroën, Tesla ainsi que les acteurs de la mobilité verte présentés par Automobile Propre et l’Ademe. La lecture attentive des mécanismes et implications fiscales devient cruciale pour anticiper les obligations de demain et optimiser la performance économique et environnementale des entreprises.
Les fondements de la nouvelle fiscalité automobile pour véhicules à faibles émissions
Au cœur de la réforme adoptée dans la loi de finances pour 2025, la fiscalité sur les véhicules à faibles émissions vise à couper court à l’utilisation massive des modèles thermiques classiques. La suppression de la Taxe sur les Véhicules de Société (TVS) en 2022 a été la première étape marquante. Désormais, deux nouvelles taxes principales encadrent l’usage des véhicules d’entreprise : d’une part, la taxe annuelle sur les émissions de CO₂, fonction des grammes émis par kilomètre du véhicule, et d’autre part, la taxe annuelle sur les émissions de polluants atmosphériques, qui considère la norme environnementale et le carburant utilisé.
En parallèle, une mesure majeure a vu le jour : la taxe annuelle incitative (TAI) applicable aux entreprises dont la flotte atteint au moins 100 véhicules. Cette taxe cible directement le verdissement des flottes et remplace les anciens quotas progressifs définis par la Loi d’Orientation des Mobilités (LOM). Cette transition réglementaire engage une méthodologie de calcul novatrice basée sur un « facteur d’écart » mesurant l’écart entre les objectifs d’intégration des véhicules légers à faibles émissions et les valeurs réelles des parcs automobiles.
La dynamique instaurée place la barre à 15 % d’intégration dès 2025, avec des cibles qui s’élèvent à 18 % en 2026 et jusqu’à 48 % en 2030. Ce mécanisme sert un double objectif : encourager l’acquisition des modèles électriques, hybrides rechargeables et autres véhicules à faible impact environnemental tout en pénalisant les sociétés optant pour la stagnation sur des solutions polluantes.
Les divers articles du code de l’Environnement et des impositions sur les biens et services définissent rigoureusement le cadre juridique d’application, éliminant l’obligation précédemment imposée par la LOM et affinant la notion d’entreprise redevable. Ce changement modifie également la gestion des durées d’usage des véhicules, la base de calcul de la taille des flottes, et adapte le poids fiscal selon la nature précise des véhicules détenus, privilégiant les données d’immatriculation plutôt que les simples commandes.
Comprendre qui est concerné et comment s’effectue le calcul de la taxe annuelle incitative
La taxe annuelle incitative (TAI) cible les entreprises « au sens large », notamment celles assujetties à la TVA qui possèdent ou gèrent une flotte automobile composée d’au moins 100 véhicules légers. Contrairement à la précédente réglementation, les véhicules détenus par des filiales ou gérés indirectement ne sont plus pris en compte dans le calcul de la taille de la flotte, ce qui modifie sensiblement la stratégie de territorialisation et d’organisation des groupes.
La loi stipule que la date clé pour intégrer un véhicule dans la flotte taxable est celle d’immatriculation, moment où son affectation économique est effective. Cela exclut ainsi les seules commandes ou intentions d’achat. Concernant la proportion de temps d’utilisation dans l’année, le principe de proratisation s’applique strictement : la taille annuelle de la flotte est corrigée au prorata des jours d’affectation économique effective du véhicule, une précision qui tient compte des livraisons échelonnées tout au long de l’année.
Le montant de la TAI résulte d’un calcul complexe intégrant plusieurs facteurs : la taille de la flotte, l’écart par rapport à l’objectif de verdissement exposé, et le taux de renouvellement des véhicules très émetteurs. Par exemple, une entreprise n’atteignant pas 15 % de véhicules à faibles émissions en 2025 sur son parc complet subira une taxation proportionnelle au nombre de véhicules manquants, estimée à 2000 euros par unité non conforme.
Des outils pratiques comme les calculateurs développés par des experts du secteur facilitent les prévisions budgétaires. Ce dispositif encourage par ailleurs un renouvellement régulier des flottes, avec un suivi trimestriel ou annuel impliquant des déclarations à la fois comptables et environnementales.
Les nouvelles règles fiscales relatives aux émissions de CO₂ et aux polluants atmosphériques
Depuis la suppression de la TVS, les taxes environnementales couvrent deux volets principaux : la contribution basée sur le niveau d’émissions de CO₂ et la taxe sur les polluants atmosphériques. Ces dispositifs s’appliquent de façon cumulative, incitant à la sélection rigoureuse des véhicules les moins impactants en termes d’émissions et de carburant.
Le calcul de la taxe sur les émissions de CO₂ varie selon le type de véhicule et son année d’immatriculation, s’appuyant principalement sur les normes WLTP pour les véhicules récents. À titre d’exemple, un véhicule émettant 120 g/km sera soumis à un barème progressif dont le coût peut atteindre plusieurs centaines d’euros par an, adapté de façon précise en fonction du nombre de jours d’utilisation effective.
Les véhicules hybrides, qui bénéficiaient d’exonérations partielles jusqu’en 2024, sont désormais pleinement intégrés dans ces calculs, ce qui modifie sensiblement leur attractivité fiscale au sein des flottes d’entreprises. En contrepartie, les modèles 100 % électriques, fonctionnant à l’hydrogène ou situés sous 60 g/km de CO₂ profitent d’exonérations totales, renforçant leur intérêt.
Au chapitre des polluants atmosphériques, la taxe adoptée en 2024 s’appuie sur la combinaison du type de carburant (essence, diesel, GPL) et de la norme Euro d’émission. Par exemple, un véhicule diesel Euro 4 ou antérieur est fortement sanctionné par un tarif annuel supérieur à celui d’un véhicule thermique sous norme Euro 5 ou Euro 6.
Ces mesures sont accompagnées d’un contrôle renforcé des exonérations et affectations, avec un focus porté sur la cohérence des justificatifs à maintenir pendant plusieurs années, pour prévenir tout risque de redressement. Ces évolutions constituent une évolution réglementaire que les grands constructeurs comme Renault, Peugeot, Citroën ou Tesla surveillent de près pour adapter leurs offres pro et contribuer aux politiques portées notamment par le Ministère de la Transition écologique et relayées par Ademe.
Déclarations fiscales, exonérations et sanctions : gérer la conformité en 2025
Les entreprises concernées doivent s’adapter rapidement aux nouvelles modalités de déclaration et de paiement des taxes. La TAI est désormais associée aux déclarations des taxes sur l’utilisation des véhicules (TVU) et remontée selon le régime fiscal de l’entité, qu’il s’agisse d’un régime normal ou simplifié de TVA. Ainsi, selon les cas, les montants sont reportés sur la déclaration CA3 ou la déclaration annuelle CA12, ou encore transmit via une annexe spécifique.
Au-delà du calcul et du paiement, l’administration exige la tenue d’un état récapitulatif annuel décrivant précisément la flotte taxable, ses caractéristiques environnementales, et sa composition, qui devra être présenté en cas de contrôle. Cette exigence vise à clarifier les données et renforcer la transparence fiscale dans un contexte de transition écologique.
Les exonérations sont possibles mais dépendent du secteur d’activité, de la nature du véhicule, ou encore du respect de plafonds liés aux aides de minimis européennes. Par exemple, certains véhicules utilitaires et les véhicules exclusivement affectés au transport public sont exonérés, tout comme certains opérateurs de transport spécialisé ou les associations sous conditions. Il est essentiel de vérifier chaque critère et d’archiver soigneusement ses justificatifs, sous peine de redressements pouvant inclure des pénalités allant jusqu’à 80 % du montant dû.


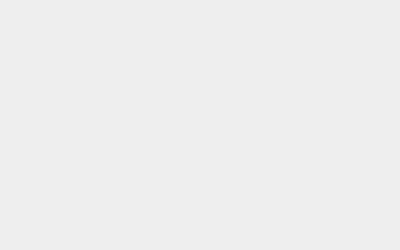


Poster un Commentaire
Vous devez vous connecter pour publier un commentaire.